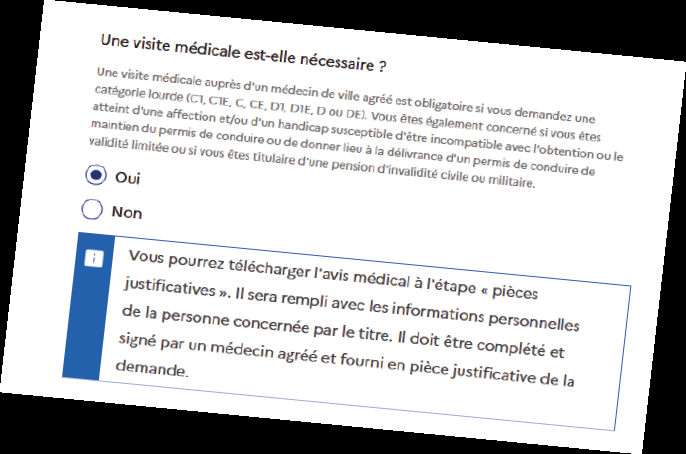Il importe, tout d’abord, de considérer l’adolescence comme un processus, un phénomène dynamique ou comme une phase de métamorphose.
Métamorphose à la fois physique, psychique et comportementale qui fait qu’en quelques mois un enfant devient méconnaissable à son entourage, mais aussi et surtout à lui-même, et devient cet « autre » (pour reprendre la magnifique formule de Rimbaud « Je est un autre ») qu’il va devoir apprivoiser.
Le défi auquel sont alors confrontés les jeunes qui grandissent avec une maladie chronique devient celui d’affronter un statut tout nouveau, une « nouvelle allure de la vie » (Georges Canguilhem).
L’entrée à l’adolescence correspond parfois à l’arrivée des premiers conflits et difficultés dans la prise en charge du diabète
À l’adolescence, on peut assister à des moments de rupture ou de rejet par rapport à un diabète (quand il a débuté dans l’enfance) qui jusque-là paraissait avoir trouvé une place familière plus ou moins équilibrée dans la vie de l’enfant.
Mais les bouleversements psychiques et physiques inhérents à l’adolescence, peuvent faire surgir un sentiment d’inquiétante étrangeté, l’étrangeté du corps et d’une identité nouvelle et provoquer une remise en question de son rapport intime au diabète.
Il faudra alors que l’adolescent traverse le chemin complexe de remaniement psychique et corporel de l’adolescence pour qu’une nouvelle adaptation au diabète se fasse avec un nouveau corps qu’il faut se réapproprier.
Le DT1 peut en effet être vécu comme une sorte d’intrus, un autre en soi, menaçant et étranger. Par définition, l’intrus c’est celui qui s’introduit de force dans un lieu sans y être invité et sans en avoir le droit.
Le chemin de l’adolescence, processus de séparation/individuation
L’adolescence constitue la dernière phase d’un processus qui a commencé depuis la naissance et qui conduit à se séparer, se différencier et s’individualiser. Ce processus de séparation peut être entravé par l’inquiétude des parents pour lesquels c’est évidemment difficile de « lâcher » leur enfant avec son diabète.
L’irruption de la maladie peut en effet provoquer une sorte de régression dans ce lien parent/enfant. L’enfant redevient parfois entièrement dépendant de ses parents alors même qu’il commençait à s’autonomiser et à s’individualiser. Les parents vivent alors souvent au rythme de la maladie.
À l’évidence, le caractère parfois imprévisible du diabète, place les parents dans une situation d’insécurité majeure et peut rendre la question de la séparation compliquée.
S’occuper d’un adolescent n’est pas simple et met les parents face à une tâche compliquée : celle de pouvoir manier la distance relationnelle ni trop près, ni trop loin.
Trop près de la menace intrusive, trop loin, du côté du vécu abandonnique que peuvent avoir les ados : « Lâche moi mais ne m’abandonne pas ! ».
L’existence d’un diabète à l’adolescence peut apparaître comme un catalyseur des problématiques inhérentes et normales à cette période de la vie : les spécificités du diabète, son caractère exigeant, intrusif et le rapprochement qu’il induit avec les parents peuvent ainsi entraver le travail d’individuation et de séparation de l’adolescent.
D’où parfois le recours à la stratégie psychique du mensonge pour s’émanciper.
Pour qu’un adolescent puisse devenir autonome, il faut qu’il ressente la confiance que ses parents ont en ses capacités d’autonomie. La vigilance excessive, la dramatisation des écarts d’observance peuvent en effet conduire sans le vouloir à un sentiment de dévalorisation chez l’adolescent.
Apprendre à faire confiance malgré ses angoisses est bien le défi le plus difficile et délicat pour les parents.
Pour conclure, quelques réflexions autour de l’adolescence, qui est une période que beaucoup de parents redoutent
Bon nombre de parents d’enfants malades sont en effet très inquiets par l’approche de l’adolescence, craignant que leur travail de plusieurs années pour que le diabète s’équilibre soit balayé par des velléités d’indépendance trop destructrices.
L’adolescence n’est pas une maladie, ni l’âge bête, c’est un mouvement plein de force et de promesse de vie.
Il convient en effet de ne jamais perdre de vue que cet âge représente aussi, quelles que soient les difficultés ou crises qui peuvent parfois émerger, l’une des périodes potentiellement les plus créatives de l’existence humaine.
Le mot adolescence vient du latin « pousser » et l’étymologie du mot crise évoque l’idée du changement.
La crise d’adolescence est un voyage vers l’avenir.
La crise d’adolescence c’est donc parvenir à dépasser l’âge de la tutelle. « Je deviens propriétaire de moi ».
Le point d’aboutissement de la métamorphose adolescente est l’apparition du sentiment d’autonomie puis à terme d’indépendance.
L’adolescent a besoin à la fois de contrôle et de liberté et le dosage est différent tous les jours et selon les circonstances.
C’est donc bien difficile d’être parent car les parents sont là pour prendre des coups ou des scuds comme disent les ados et, d’un autre côté, ils sont là pour protéger et contenir l’adolescent.
C’est très dur d’accepter d’être l’objet d’une tension très forte qui peut être dirigé contre eux.
Pour le docteur Courtecuisse : « l’adolescence est par excellence le temps où il faut savoir « surveiller », c’est-à-dire veiller sur, d’en haut, sans conduite intrusive mais en étant là au moment nécessaire.
Extrait de l’article « Le diabète à l’épreuve de l’adolescence » par Nadine Hoffmeister, Psychologue clinicienne. Revue AJD n°02-2021
Pour commander cette revue ou t’abonner, c’est par ici.